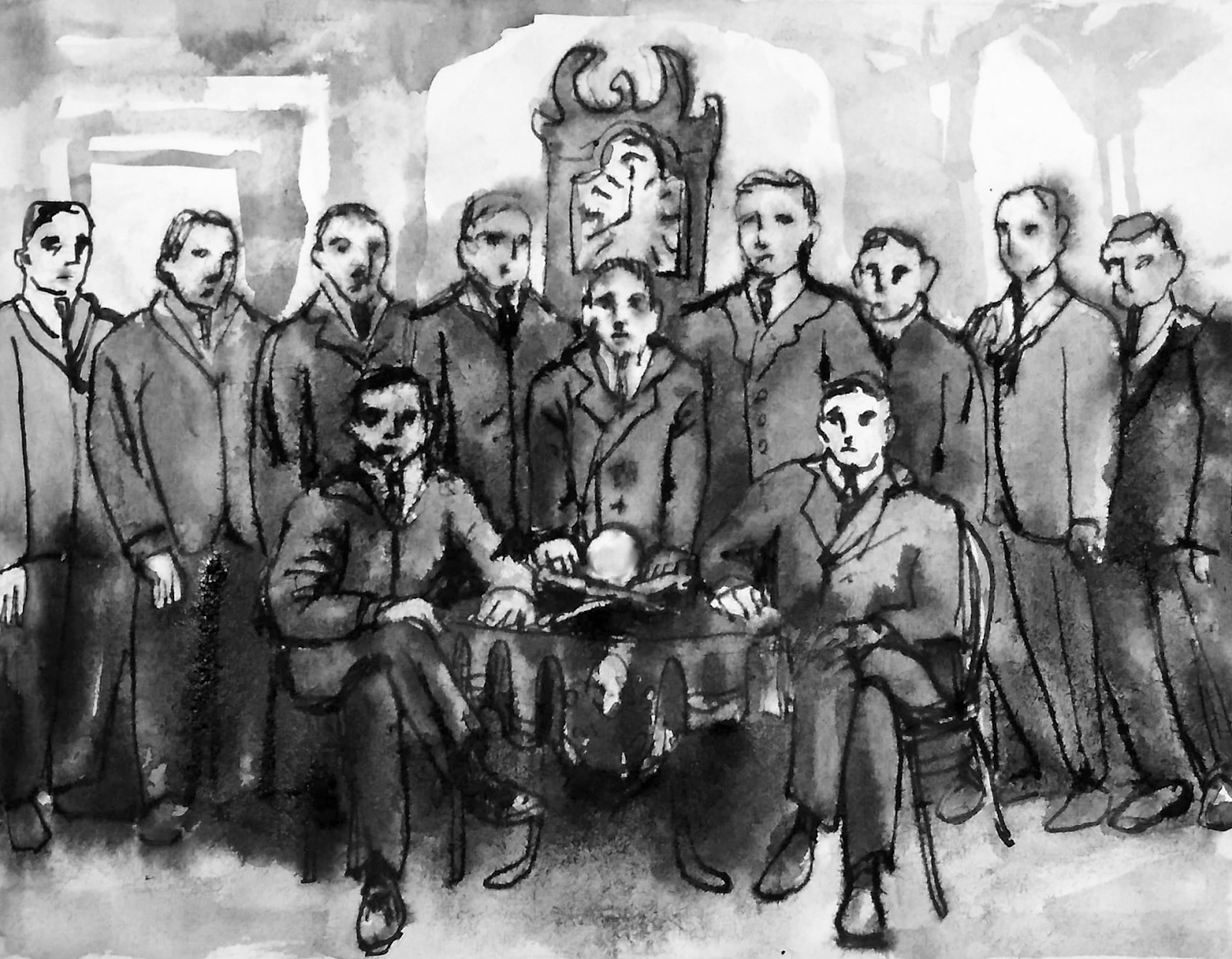L’apparition des études de genre dans le champ des sciences sociales a permis d’introduire une nouvelle variable qui était jusqu’ici ignorée : les femmes. Au-delà d’inclure une frange non-négligeable de la société dans l’étude des faits sociaux, cela a donné l’opportunité au mouvement féministe d’appuyer ses revendications sur des études scientifiques.
Par exemple, l’étude des tribus autochtones de Nouvelle-Guinée par l’anthropologue Margaret Mead ont permis d’attester du rôle central de la socialisation dans le tempérament des individus en fonction de leur sexe, et donc de déconstruire l’idée de la “femme-émotion” et de “l’homme-raison” [1]. Mais la réappropriation politique des productions scientifiques amène à une hostilité envers les études de genre qui remettent en cause l’ordre sexué.
Aux origines de la “crise de la masculinité”
En 1985, paraît l’article collectif “Toward a new sociology of masculinity” dans la revue Theory and Society [2] qui révolutionne la sociologie du genre. Alors que jusqu’ici, dominait une perception essentialiste du genre féminin et masculin, niant la diversité de leurs caractéristiques en fonction des contextes sociaux, Tim Carrigan, Raewyn Connell, et John Lee procèdent à une conceptualisation relationnelle de ceux-ci. Le féminin et le masculin sont perçus comme des identités qui se construisent au travers d’interactions. C’est donc contre une approche positiviste (“ce que les hommes sont”) qu’apparaît une approche normative (“ce que les hommes doivent être”). Cette émergence de l’étude des masculinités dans la sociologie du genre – principalement centrée à l’origine sur l’identité de genre féminin – permet de procéder à une investigation théorique et empirique plus riche des rapports de genre tels qu’ils sont socialement construits. Cela permet aussi, au delà de la construction d’un idéal-type de la masculinité défini à travers la notion de masculinité hégémonique, de mettre en évidence sa diversité, notamment grâce à la reconnaissance d’une consubstantialité du genre. Elaboré par Danièle Kergoat, le concept de consubstantialité « permet de décrire la manière dont celles-ci [les oppressions] s’interpénètrent, se croisent et se logent au creux même de la formation des classes sociales » [3]. Le genre se construit donc, non seulement au travers de contextes sociaux, mais aussi au travers de la race sociale, de la classe économique, de l’orientation sexuelle, et par la classe dominante.
Et si l’absence d’homogénéité de la masculinité ne permet pas la constitution cohérente d’une théorie générale de celle-ci, les masculinities studies ont pu toutefois mettre en exergue des caractéristiques communes dans les différents contextes sociaux, permettant d’élaborer un idéal-type de la masculinité. En effet, l’hégémonie comme « dynamique culturelle par laquelle un groupe revendique et maintient une position sociale de leadership » caractérise la masculinité en ce sens que, qu’elles que soient ses caractéristiques, le genre structure la vie sociale à trois niveaux : pouvoir, production et sexualité/désir. Toutefois, comprendre le genre en tant que dynamique sociale ne doit pas aboutir à un rejet absolu de son approche positiviste, car étudier les masculinités nécessite de s’emparer aussi de leurs constructions essentialistes. En effet, le genre renvoie constamment au corps qui constitue une des sphères les plus importantes de l’identité et de la construction du genre. Il y a une forme de supposée mécanique du corps qui dirige (exemple : le viol comme conséquence de la pulsion sexuelle innée, dû à un désir sexuel incontrôlable) et limite (exemple : l’investissement paternelle limité, du fait que les femmes seraient naturellement plus et mieux loties que les hommes pour pouvoir s’investir dans le soin et l’éducation des enfants) nos actions en fonction de notre genre. De plus, au delà de sa conception matérialiste, il existe une “métaphysique” du genre, c’est-à-dire l’idée d’une essence du masculin et du féminin qui constitue un ordre naturel. Cette théorie est notamment défendue par le mythopoetic men’s movement qui cherche à fonder un renouveau des rapports sociaux de genre dans les sociétés contemporaines, marquées par l’influence des mouvements féministes, à travers le folklore et la mythologie. Plus précisément, ce mouvement a pour but de créer des groupes d’entraide psychologique non-mixtes pour hommes, afin de leur permettre de se reconnecter à leur essence masculine mise à mal par les mouvements féministes. Le fondateur de ce mouvement, Robert Bly, estime qu’il est nécessaire pour les hommes de posséder « l’énergie de Zeus », soit, une « autorité masculine acceptée pour le bien de la communauté » car il y a une essence du masculin (et du féminin) qui ne peut et ne doit être modifiée, cela pouvant s’avérer “dangereux” [4].
Pour comprendre les masculinités, il est donc aussi nécessaire de se pencher sur les rapports qu’entretiennent les hommes avec cette norme. Cela permet à la fois de rendre explicite leur subordination, validation, et même complicité à cette structure hiérarchique, mais aussi de rendre évident la marginalisation et/ou le rejet de certains hommes, voire de comprendre comment la complicité peut aussi être perçue comme une stratégie de survie mise en place par les hommes par l’expression d’une “masculinité mascarade” (pour reprendre le concept de “féminité mascarade” introduite par Joan Rivière). Pour autant, l’intérêt pour le regard que les hommes portent sur la masculinité a pour danger de faire basculer le questionnement sur la classe dominante qu’ils constituent, de risquer de leur permettre de revendiquer une oppression de genre et donc de centraliser la problématique sur leurs intérêts. En effet, il est assez commun qu’un système discriminant mute de sorte à s’adapter aux armes qui tentent de le déconstruire, et ce n’est pas sans surprise que le patriarcat s’approprie progressivement les outils qui cherchent à le démanteler, permettant de rendre la hiérarchie moins visible et donc plus vicieuse. Raewyn Connell refuse donc une autonomisation des masculinities studies qui doivent obligatoirement être pensées dans l’ensemble des rapports de genre.
Par conséquent, féminité et masculinité sont des identités sociales plurielles, relatives et inconstantes, caractérisées par une hiérarchie qui suppose le plus communément qu’en plus d’être opposé à la masculinité, la féminité y est inférieure. Cette thèse est rejetée et combattue par les masculinistes qui y voient une menace pour les hommes et l’ensemble de l’ordre social. En intégrant les masculinistes studies, la sociologie du genre n’a pas seulement osé supposer que les femmes pouvaient incarner des normes socialement perçues comme intrinsèquement masculines (et vice-versa), elle a aussi osé supposer que la hiérarchie existante ne reposait sur rien de légitime. Il s’agit donc d’une menace à l’autorité masculine.
Le masculinisme : contre qui et pourquoi
La définition du terme “masculinisme” a, depuis le XIXe siècle, évolué. Dans le dictionnaire Trésor de la langue française on retrouve une définition du masculinisme qui correspondrait plutôt à un antonyme du féminisme comme on pouvait l’entendre à cette époque. Le féminisme étant considéré comme une pathologie chez un homme affichant des caractéristiques dites féminines, le masculinisme était une pathologie chez la femme qui affichait des caractéristiques dites masculines. C’est à partir des années 1980, que le masculinisme est associé à une idéologie politique conservatrice. Pour autant, les premières définitions du masculinisme n’en font pas un mouvement social. Au contraire, elles laissent d’abord penser à une forme de fait social. Rebecca West et Sheila Ruth parlent de « forme de sexisme pratiquée dans notre culture ». La définition deviendra par la suite progressivement explicitement politique. Cheris Kramarae et Paula Treichler le définisse comme « le principe central du patriarcat », et Arthur Brittan comme ce qui « justifie et naturalise la domination masculine […] et […] réaffirme le rôle dominant et politique de l’homme dans les sphères publique et privée ». Il devient donc une notion permettant d’analyser des phénomènes de tentative de re-traditionalisation de rôles sexués, par « une résistance à la féminité, aux forces qui adoucissent les hommes » (Michael Kimmel). Et si on a pu observer une tentative de réappropriation de la notion de masculinisme par les hommes pro-féministes qui le définissent plutôt comme « un processus de prise de conscience que comme hommes, nous sommes aliénés par un modèle que d’autres hommes ont imposé comme dominant » (Germain Dulac), globalement le masculinisme et ce qu’il inspire est associé à l’idéologie d’une droite conservatrice et anti-féministe. Il est parfois remplacé chez les pro-féministes par le terme de “hominisme” à cause de la réappropriation du terme “masculinisme” par les féministes qui, pour eux, entache l’image que la société a de leur mouvement. Ces hoministes, d’après ce que laisserait croire le Manifeste rédigé par Yvon Dallaire, John Goetelen et Patrick Guillot, ne s’opposeraient pas à la lutte contre la misogynie et ne s’affirme donc pas comme un anti-féminisme. Néanmoins, ce même Manifeste démontre qu’ils sont tout aussi adeptes des mêmes rhétoriques masculinistes classiques sur la prétendue ascension d’une société misandre, d’une supposée justice contre les pères, d’une existence fondamentale et naturelle d’une binarité des genres, et d’une égale responsabilité des hommes et des femmes en ce qui concerne les violences sexistes. Finalement, malgré des tentatives de réappropriation du terme et de distinction vis-à-vis de la droite conservatrice, « l’hoministe est […] antiféministe, quoi qu’il en dise. » (Francis Dupuis-Déri).
Le mouvement masculiniste est donc un mouvement qu’on peut qualifier “d’auto-défense”, mais contre qui et dans quel but ? Le mouvement est le fait de ce qu’il désigne comme étant une “crise de la masculinité”, ou plutôt des crises de la masculinité, au pluriel, car historiquement, la rhétorique de la féminisation de la société sur laquelle s’appuie principalement le masculinisme n’est pas neuve. Cette rhétorique est d’ailleurs souvent utilisée durant des périodes clés de l’Histoire. Par exemple, en France, on a entendu parler de “crise de la masculinité” à la Renaissance et durant la Révolution. Dans d’autres pays, on peut penser à l’Allemagne du XIXe siècle, à l’Italie fasciste des années 1920 et 1930, ou encore aux Etats-Unis de Ronald Reagan, moment même où le pays s’affirme comme une puissance économique et militaire face aux communistes. En somme, la montée du masculinisme est souvent associée à des périodes de troubles de l’ordre social et politique (guerre, révolution, etc.), périodes où les pays concernés vont re-façonner leur identité nationale par une re-traditionalisation des normes et des valeurs. Historiquement, la “crise de la masculinité” est donc indissociable d’une idéologie conservatrice. Ceci pourrait s’expliquer du fait que l’ordre soit souvent perçu par une distribution de rôles sociaux à assurer pour chaque membre de la société, dans le but de permettre une cohésion et une unité sociale. Néanmoins, on pourrait se dire que cette cohésion pourrait se trouver dans une forme de solidarité équitable, et non dans une société hiérarchisée. En réalité, le désordre social est lié plus généralement aux changements sociaux de type progressiste, consistant à l’acquisition de droit pour des individus traditionnellement minorisés. En somme, il n’est pas nécessaire d’avoir un trouble social concret comme une guerre ou une révolution pour qu’un sentiment de trouble soit ressenti. Le simple fait pour des personnes appartenant à une minorité d’acquérir des droits est, en soi, un facteur de désordre social. Par exemple, durant le Moyen-Âge en France, on observe une montée en puissance du rôle des femmes dans les institutions politiques : on estime à 20% le taux de femmes présentent dans les assemblées de villages. La période de la Renaissance qui suit le Moyen-Âge sera marquée par le développement d’une plus forte distinction entre les sexes. Le masculinisme est donc une idéologie de normes traditionnelles, hostile aux changements progressistes qui s’attaquent à la structure pyramidale de la société.
Souvent caricaturé, on pense le masculinisme comme un mouvement marginal, dont les acteurs appartiendraient à de micro boy’s clubs virtuels, et qui se retrouvent sur des forums afin d’échanger entre eux. La réalité est toute autre : le masculinisme est un mouvement social qui est déjà intégré dans la vie politique. Pour autant, là où le masculinisme peut sembler singulier, c’est qu’il n’y a pas d’objectif d’inclusion sociale ou politique, mais une logique de conservation et de re-traditionalisation de la vie sociale et politique. Autrement dit, ce ne sont pas des individus intégrés socialement de manière partielle (voire pas du tout) qui voudraient obtenir un poids politique plus conséquent, ce sont des individus déjà intégrés socialement et politiquement, cherchant à conserver leurs privilèges, et donc à maintenir la structure pyramidale de la société dans laquelle ils se trouvent. En ce qui concerne les actions collectives, il est assez rare d’observer des actions populaires qui prendraient la forme de grèves, d’émeutes ou de manifestations. Toutefois, l’essor des communautés numériques masculinistes permet de relativiser ce dernier point : les campagnes de harcèlement en ligne peuvent être analysées en terme d’actions collectives, puisqu’elles sont organisées (déterminer une cible et les caractéristiques qui en font un ennemi politique, communiquer les réseaux de la cible aux autres membres du groupe, harceler en groupe directement ou indirectement la cible). De plus, s’il y eut, exceptionnellement, quelques rares rassemblements explicitement portées par les masculinistes comme à Bruxelles en 2016, on pourrait néanmoins admettre que tout rassemblement porté par un mouvement de droite [extrême] peut-être associé, dans une certaine mesure, au mouvement masculiniste, puisqu’il s’agit du même agenda politique.
Christie Kainze-Mavala
Illustration réalisée par Salomé Taverne
[1] MEAD Margaret, Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée (1935)
[2] CARRIGAN Tim Carrigan, CONNELL Bob (ancien nom d’usage de Raewyn Connell), LEE John.“Toward a new sociology of masculinity”, Theory and Society, 1985, Vol. 14, n°15, pp. 551-604
[3] Citée dans Pour un féminisme de la totalité (2017) de BOGGIO EWANJE-EPEE Félix et MAGLIANI-BELKACEM Stella (dir.)
[4] BLY Robert, Iron John: A Book About Men (1984)
Sources
CONNELL Raewyn, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie (2014)
DUPUIS-DERI Francis. “Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus de l’égalité entre les sexes : histoire d’une rhétorique antiféministe”, Cahiers du Genre, vol. 52, n° 1, 2012, pp. 119-143. En ligne : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-1-page-119.htm
DUPUIS-DERI Francis. “Le « masculinisme » : une histoire politique du mot (en anglais et en français)”, Recherches féministes, vol. 22, n° 2, 2009, pp. 97–123. En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2009-v22-n2-rf3635/039213ar/