Depuis plusieurs décennies déjà, les environnementalistes tirent la sonnette d’alarme quant au réchauffement climatique et ses répercussions irréversibles sur la Terre alors que Greta Thunberg, comme un symbole à cette cause, refusait il y a quelques jours le Nordic Council’s Environmental Award 2019, jugeant que le mouvement pour le climat n’avait pas besoin de récompense [1].
Dans ce contexte, le continent asiatique fait figure de vilain petit canard, l’Inde, la Russie et la Chine constituant le top 3 des plus gros émetteurs de dioxyde de soufre en 2017, l’un des principaux polluants atmosphériques, d’après des recherches combinées de Greenpeace et de la NASA [2]. Si la place de l’Empire du Milieu dans cet énième palmarès n’est pas une surprise, nous n’évoquerons pas son cas ici mais celui de Taïwan, trop souvent confondu avec sa voisine continentale.
Taïwan, une figure environnementale de proue en Asie ?
Taïwan, ou la République de Chine (ROC), ne cesse de vouloir se différencier de la République Populaire de Chine (PRC), la Chine continentale, qui la revendique : l’une utilise les caractères traditionnels, l’autre les caractères simplifiés, l’une est démocratique, l’autre non, les toilettes publiques de l’une sont d’une propreté irréprochable, celles de l’autre… (on dévie du sujet ?). Est-ce à dire que la question environnementale est mieux considérée à Taïwan qu’en Chine et que l’île de Formose puisse devenir une figure de proue du mouvement environnementaliste en Asie ? Taïwan est une île aux nombreux parcs protégés, à la côte ouest naturelle et sauvage très peu investie, les villes et même la capitale Taipei regorgent d’espaces verts et de parcs luxuriants tandis que le gouvernement s’efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dont 90%, selon le Ministère de la Protection Environnementale, sont dues aux émissions de carbone [3]. Pourtant, Taïwan et la Chine continentale partagent un point commun : l’attrait pour la religion et les traditions. Or, tradition et environnement ne s’accordent pas toujours.
Tradition et environnement : une rupture irréconciliable ?
Comme nous le rappelle Vincent Goossaert dans un article à propos de l’ouvrage de Philippe CLART, Religion in Modern Taiwan. Tradition and Innovation in a Changing Society, [4] « la récente libéralisation sociale et politique à Taïwan […] s’est accompagnée d’une forte augmentation, en nombre et en variété, des formes de renouveau religieux, ainsi que d’une véritable explosion des recherches sur la religion des Taïwanais. » Quand on a la possibilité de faire l’expérience de cette religion à Taïwan et d’appréhender l’importance de la tradition dans la vie quotidienne, on ne peut qu’être stupéfait de la vigueur de la pratique en comparaison à l’essoufflement du christianisme en France. Religion et tradition font partie intégrante de l’identité taïwanaise et cela peut entrer en confrontation directe avec l’urgence climatique.
Un phénomène marquant lorsque l’on se rend à Taïwan, notamment au mois de février, c’est la fameuse Fête des Lanternes. Des milliers de lanternes s’élèvent dans l’obscurité comme d’innombrables lucioles embrasant le ciel. Un spectacle magnifique à voir et pas besoin de se rendre à Taïwan en février puisque la ville de Shifen (十分), dans le district de Pingxi à l’est de Taipei, offre à ses visiteurs l’opportunité de lâcher une lanterne, sur les rails d’un train de la vieille rue (Old Street), après y avoir inscrit ses vœux qui, dit-on, arriveront au Paradis. Une attraction relativement bon marché puisqu’une lanterne coûte environ 150NTD soit un peu moins de 5€. Pas besoin non plus de marcher beaucoup de kilomètres pour se rendre compte que ces lanternes sont loin d’atteindre le Septième Ciel pour bel et bien se crasher dans la forêt environnante. Le spectacle est déconcertant. Sur le chemin de la cascade de Shifen, l’une des attractions touristiques majeures de la ville, de nombreux morceaux de papier huilé brûlé jonchent le sol, souvent suspendus aux arbres ou simplement en train de se décomposer dans la rivière. Un phénomène d’autant plus risible, ou consternant, quand on considère la valeur qu’a la nature aux yeux des Taïwanais dont « la particularité des composantes naturelles est si important pour la construction identitaire d’une « nation taiwanaise », dissociable de celle de la Chine. » [5] En France, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire invite, par ailleurs, à « limiter l’utilisation de ces produits, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent dans la nature. » [6]
La religion n’est pas en reste non plus question écologie. La première chose qui frappe lorsque l’on pénètre dans un temple taïwanais, c’est la grande beauté et solennité des lieux mais aussi l’odeur, l’odeur de fumée. Entre les milliers de bâtons d’encens brûlés chaque jour, sans compter les innombrables faux-billets brûlés dans ces grands fours à la vue (et au nez) de tous pour envoyer de l’argent aux ancêtres, l’addition est vite faite, et elle est énorme. Une étude de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en date de 2017 rapporte que « l’utilisation des bâtons d’encens se traduit par des concentrations élevées en benzène, toluène, éthylbenzène, styrène, formaldéhyde, acétaldéhyde et acroléine » décrites comme « substances d’intérêt prioritaires » [7] notamment pour la santé mais aussi pour l’environnement, au vu des particules fines relâchées lors de la combustion. Pour remédier à ce problème, le Temple de Longshan, dans le cœur historique de Taipei, décide en 2017 de limiter le nombre de bâtons d’encens pouvant être brulés par les fidèles, suivi d’une décision allant dans ce sens à l’échelle du gouvernement. [8] Toutefois, les protestations sont nombreuses tandis qu’en juillet 2017, 10 000 personnes participaient à une procession taoïste dans les rues de Taipei, et cela n’est pas près de changer. [9]
En ce mois de novembre 2019, toujours autant de lambeaux de lanternes se retrouvent dans les forêts de Shifen, toujours autant de fumée aveuglent et étouffent dans les temples bouddhistes et taoïstes de Taïwan et pas sûr que les alternatives numériques proposées n’y changent grand-chose. Partie intégrante d’une culture ancestrale, la vente de lanternes, de bâtons d’encens, de faux-billets, est aussi une action rémunératrice importante et permet de générer des fonds pour entretenir ces lieux sacrés. Taïwan peut certainement revendiquer sa différence d’avec son voisin chinois pour tout un tas de raison. Pourtant, comme en Chine continentale et comme dans de nombreux pays asiatiques, elle doit faire face à un défi majeur, celui de faire passer la question environnementale et les générations futures avant les traditions qu’elle a reçues de son passé glorieux. Pas sûr que l’urgence écologique ait un poids suffisant pour contrebalancer des millénaires d’héritage.
Lucile Landais
Correspondante à Taïwan
Illustration réalisée par Paul Meslet
[1] Compte Instagram de Greta Thunberg : « the climate movement does not need any more awards »
[2] Greepeace. Global SO2 emission hotspot database. https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/08/e40af3dd-global-hotspot-and-emission-sources-for-so2_16_august-2019.pdf; https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qkTf-y6jxARFtkU5MHaJv_ZA7T_pJDmv&ll=25.343483039178693%2C122.04493758547119&z=5; Greenpeace. Greenpeace analysis ranks global SO2 air pollution hotspots. 19/08/2019. https://www.greenpeace.org/international/press-release/23819/global-so2-air-pollution-hotspots-ranked-by-greenpeace-analysis/
[3] Taiwan Info. Taiwan agit pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 25/09/2019. https://taiwaninfo.nat.gov.tw/news.php?unit=68&post=162832&unitname=Nature-Taiwan-Info&postname=Taiwan-agit-pour-r%C3%A9duire-ses-%C3%A9missions-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre
[4] Disponible sur https://journals.openedition.org/assr/2414#authors
[5] Fiorella ALLIO. La nature et sa patrimonialisation à Taiwan. The place of nature in Taiwanese heritage construction. 2008. https://journals.openedition.org/gc/3705
[6] Disponible sur : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lachers-ballons-et-environnement
[7] Disponible sur : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-pollluants-bougies-encens-environnements-interieurs_2017_synthese_v2.pdf
[8] Taïwan Info. Pollution aux particules fines : le temple de Longshan limite davantage l’usage de l’encens. 07/03/2017. https://taiwaninfo.nat.gov.tw/news.php?unit=68&post=112220
[9] Le Parisien. À Taïwan, au moins 10 000 personnes dans la rue pour défendre l’encens. 23/07/2017. http://www.leparisien.fr/international/a-taiwan-au-moins-10-000-personnes-dans-la-rue-pour-defendre-l-encens-23-07-2017-7152327.php
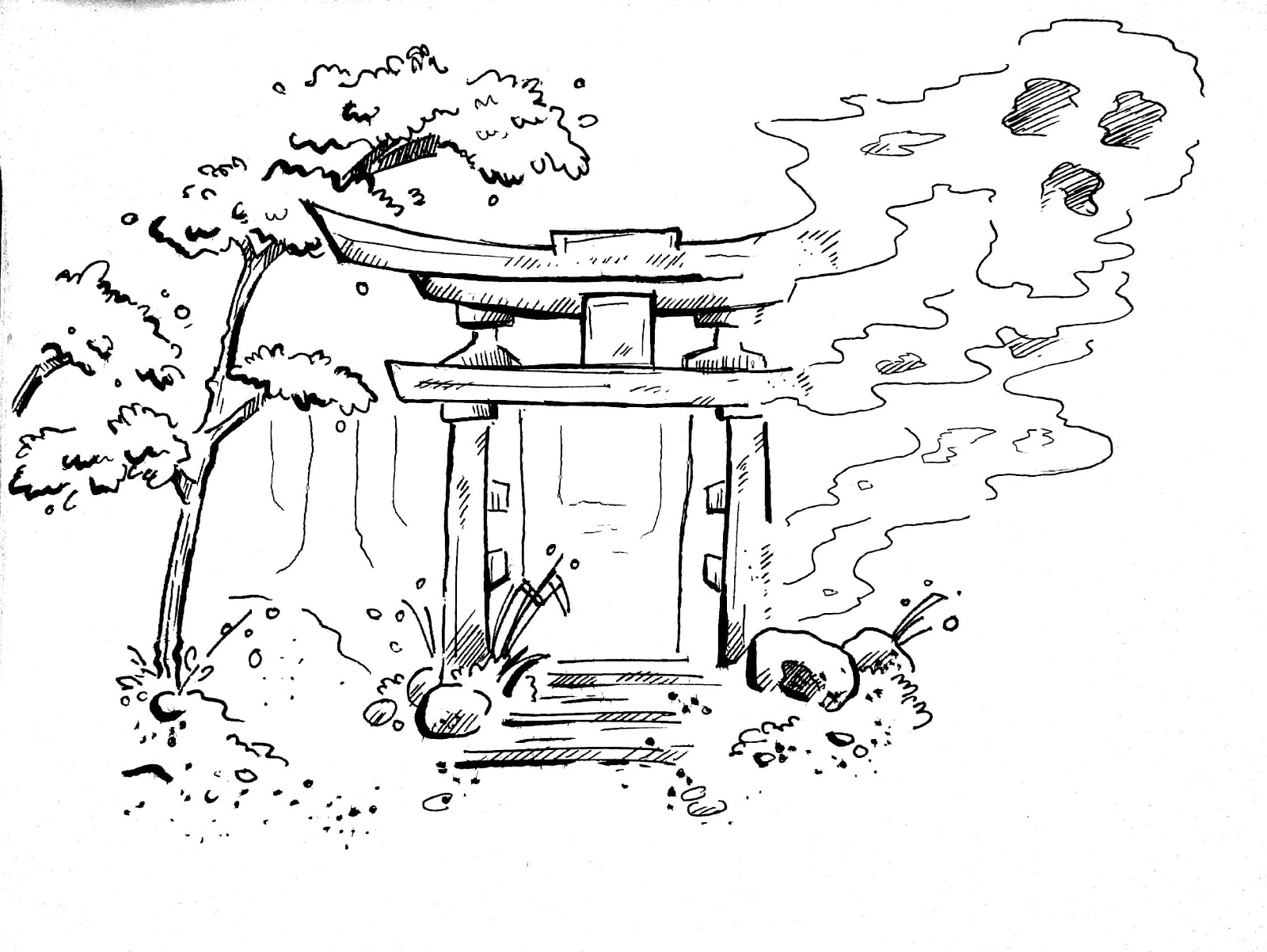
Effectivement, il y a beaucoup à dire sur les freins exercés par les traditions religieuses sur le développement harmonieux de la nature (sa faune, sa flore…). On pourrait étendre le sujet au développement des droits de l’Homme, au premier rang desquels, ceux des femmes. En tout cas, félicitations à l’auteure de cet article, pour sa contribution au questionnement autour de pratiques polluantes non liées à un cycle, à un projet industriel, mais liées aux cultures au caractère immuable.
J’aimeJ’aime